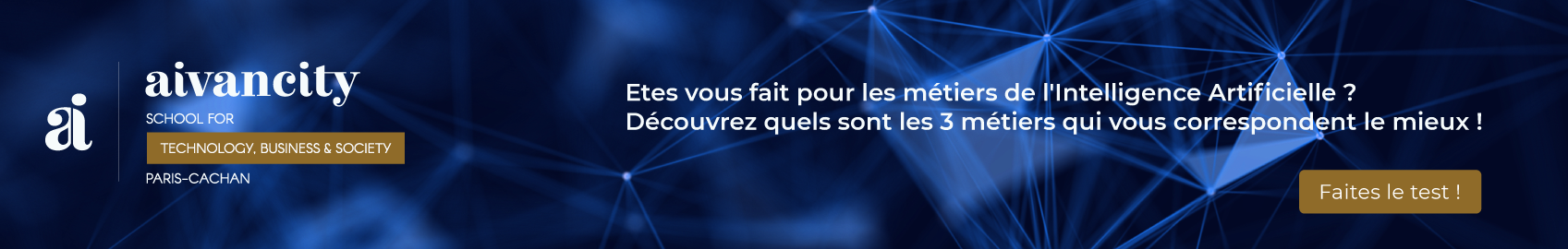Par Pr Nathalie DEVILLIER Docteur en Droit International
Ce cas nous rappelle qu’il est essentiel de dépasser le battage médiatique, surtout lorsqu’il peut menacer nos droits fondamentaux, notamment la protection de la vie privée.
Depuis quelques jours, des images générées par le dernier outil d’OpenAI inondent les réseaux sociaux. Ces créations, fortement inspirées du style du Studio Ghibli – célèbre pour des films comme Mon voisin Totoro ou Le Voyage de Chihiro – ont déclenché un phénomène viral baptisé l’« effet Ghibli ». Si cette tendance séduit par son esthétique, elle soulève des questions cruciales sur le droit d’auteur et la confidentialité des données personnelles.
Quand l’IA reproduit des styles protégés
D’un point de vue juridique, le simple fait de reproduire un style artistique ne constitue pas, en soi, une violation du droit d’auteur. Toutefois, la capacité d’une IA à générer des images dans un style spécifique avec une fidélité troublante soulève une interrogation majeure : a-t-elle été entraînée sur des œuvres protégées ?
OpenAI a-t-elle obtenu des licences du Studio Ghibli ou d’autres créateurs pour utiliser leurs œuvres comme base d’apprentissage ? Rien ne permet de l’affirmer. Aux États-Unis et ailleurs, des poursuites judiciaires se multiplient contre OpenAI et Anthropic pour violation du droit d’auteur. Des auteurs, artistes et créateurs dénoncent l’utilisation non consentie de leurs œuvres par les modèles d’IA, sans compensation ni accord préalable.
Ce débat dépasse largement le seul cadre artistique. Si une IA peut recréer des images dans un style protégé, où se situe la frontière entre l’inspiration légitime et la reproduction abusive ?
Des images personnelles en libre accès : le piège du consentement implicite
L’« effet Ghibli » ne pose pas uniquement un problème de droit d’auteur : il a aussi des implications majeures en matière de protection des données personnelles.
Dans l’Union européenne, OpenAI justifie l’entraînement de ses modèles sur des images récupérées en ligne en invoquant l’« intérêt légitime » (article 6.1.f du RGPD). Toutefois, cette base juridique impose des obligations strictes, notamment la mise en place de garanties pour éviter l’exploitation abusive de données sensibles.
Mais une autre problématique surgit : le consentement des utilisateurs. Pour obtenir leur propre portrait façon Ghibli ou dans un autre style, des milliers d’internautes téléchargent volontairement leurs photos sur la plateforme. Or, en le faisant, ils acceptent les conditions générales d’OpenAI et autorisent l’entreprise à exploiter leurs images (article 6.1.a du RGPD).
Le résultat ? OpenAI accède gratuitement à une immense base de nouveaux visages sans avoir besoin de les extraire des réseaux sociaux. Pire encore, ces photos peuvent inclure des clichés privés, comme des images de famille ou des photos intimes, qui n’étaient pas initialement accessibles sur Internet. Pendant ce temps, les plateformes concurrentes ne peuvent voir que la version « Ghibliisée » de ces images, ce qui confère à OpenAI un avantage stratégique considérable.
Vers un encadrement plus strict de l’IA générative
Les conséquences de cette situation ne sont pas anodines. D’une part, les artistes se retrouvent confrontés à un système capable d’imiter leur travail sans qu’ils aient leur mot à dire. D’autre part, les utilisateurs fournissent involontairement à la plateforme une précieuse ressource : leurs données personnelles.
Face à ces enjeux, les régulateurs du monde entier commencent à réagir. Le Comité européen de la protection des données a rappelé dans son Avis 28/2024 que ces plateformes doivent impérativement respecter les principes du RGPD. D’autres juridictions, comme certains États américains, envisagent des réglementations plus strictes pour encadrer l’usage des données personnelles par l’IA.
Mais ces efforts seront-ils suffisants ? L’intelligence artificielle évolue plus vite que les cadres juridiques et les risques d’exploitation abusive persistent. Tant que des garde-fous clairs et efficaces ne seront pas mis en place, le vide juridique sera une opportunité exploitée par les entreprises au détriment des artistes et de la vie privée des utilisateurs.
L’« effet Ghibli » met en lumière les tensions croissantes entre intelligence artificielle, droit d’auteur et protection des données personnelles. D’un côté, les artistes voient leur style reproduit sans contrôle. De l’autre, les internautes livrent involontairement des informations sensibles à une IA toujours plus vorace.
Ces questions ne sont pas anecdotiques : elles dessinent l’avenir de la création et de la vie privée à l’ère de l’IA. Loin d’être une simple tendance esthétique, ce phénomène illustre les défis majeurs que les législateurs et les régulateurs devront relever pour protéger les droits des créateurs et des citoyens face aux nouvelles avancées technologiques.